
Depuis plusieurs semaines, ceux qui craignent ou qui espèrent,
ceux qui spéculent comme tous ceux qui cherchent à raisonner juste à propos de
l'explosion éventuelle de la Zone Euro attendaient le verdict de la cour
constitutionnelle de Karlsruhe.
Tout semblait suspendu à cette décision.
Certains imaginaient que les 8 juges rouges iraient mettre
l'édifice en pièces. On l'avait débord bricolé puis consolidé, au gré des trois
années de crise. Les peuples grec, espagnol et irlandais en ont payé le prix
fort. Clef de voûte du système futur, le Mécanisme européen de stabilité devait
donc initialement entrer en vigueur en juillet. La date en fut repoussée en
attente du jugement. À l'issue de la réunion de l'Eurogroupe à Nicosie son
président M. Jean-Claude Juncker considérait le 14 septembre que le
dispositif pourra intervenir en octobre. (1)⇓
Or, le nouveau système comportera des dispositions tout à fait
novatrices quant à la construction de ce qui se pense comme un bloc politique
appelé Europe. (2)⇓
À Karlsruhe, en effet, le 12 septembre, le tremblement de
terre ne s'est pas produit. Observons qu'il eût contredit toute l'histoire
pratique de cette institution. L'apolitisme de ce tribunal, gardien de la Loi
fondamentale adoptée outre-Rhin en 1949, le distingue, en effet, fortement, de la
Cour suprême des États-Unis. En aucun cas il ne fallait s'attendre de sa part à
une rupture bouleversante.
À défaut du cataclysme envisagé, on gagnerait cependant à
considérer le contenu de cet arrêt. Car il manifeste une forme de secousse
sismique. Il confirme les jurisprudences antérieures de la même instance. En
l'espèce, il limite l'engagement de l'Allemagne à une participation en capital.
Celle-ci s'élèvera donc à 190 milliards d'euros, mais pas plus. Cet
engagement considérable se rapporte à des fonds propres d'ensemble eux-mêmes
limités à 500, dont Berlin détiendra une part de 38 %. On se situe donc
très loin de l'illusion aussi trompeuse que récurrente de "l'Allemagne
paiera". Certes nos voisins et amis fourniront le plus gros effort mais
cela ne doit pas conduire à des subventions à fonds perdus pour systèmes sociaux
voués à la faillite. Les prêts ont vocation à être remboursés.
On peut même regarder, – à la fois logiquement, du point de vue
de la finance, et paradoxalement, aux yeux des esprits formatés par le
marxisme, "conscient" ou "inconscient"– qu'au gré d'une
telle doctrine, le différentiel d'intérêts rapportera de l'argent aux pays qui,
disposant d'un meilleur crédit pour eux-mêmes, en feront partiellement
bénéficier les États-Membres en difficulté. (3)⇓
La chancelière Angela Merkel disposera, au bout du compte,
d'une liberté de manœuvre encore plus forte que prévu.
Les vrais perdants sur la scène politique intérieure
paraissent donc ses deux ministres ronchons, ses faux amis, Wolfgang Schäuble
et Philipp Rösler, qui ne pourront plus savonner la planche sur laquelle leur
rivale et néanmoins chef de gouvernement s'efforce d'avancer.
Mais, sur la scène européenne, ne nous leurrons pas. Le
partenaire parisien va se trouver singulièrement affaibli.
Certes financièrement l'opération se présente quand même comme
un soutien considérable de l'Allemagne, et des pays du nord, aux pays du sud de
l'Europe en difficulté. On doit le reconnaître pour plus favorable que
n'acceptent de le voir les sympathiques défenseurs des surendettés, toujours si
généreux avec l'argent d'autrui,
En échange toutefois,le gouvernement de Berlin et les
autorités de Bruxelles et de Francfort pourront pratiquement imposer leur
logique, habituellement désignée pour "fédéraliste". Le sens de ce
mot a beaucoup évolué, depuis deux siècles. Rappelons qu'aux États-Unis il
désigne les partisans d'un pouvoir central le plus fort possible, et qu'en
français au contraire il s'oppose au centralisme jacobin.
On se propose aujourd'hui en effet de structurer l'Europe à
partir des pays adhérents à la monnaie unique. On a même évoqué l'hypothèse
d'un Parlement limité aux membres de la zone euro. Ce point, aussi peu
réaliste qu'effectivement dangereux, n'est quand même pas apparu fortuitement.
Les quatre principaux responsables communautaires ont semblé y souscrire, aussi
bien MM. Barroso que Van Rompuy, Mario Draghi que Jean-Claude Juncker.
Or, l'avancée des projets fédéralistes intervient dans le
contexte d'une atmosphère actuellement glaciale entre Hollande et Merkel, ce
qui change considérablement la donne.
Pendant plus d'un demi-siècle, en effet, on nous a parlé de
"construction européenne". [Cette appellation conventionnelle masque
une partie de la réalité, puisque le continent possède une identité fort
ancienne.] L'essentiel en a longtemps reposé sur l'entente entre les
gouvernements français et allemand. Comme l'écrivait le grand spécialiste du
sujet le professeur Alfred Grosser, Paris avait remplacé son ancienne doctrine
anti-germanique, par une politique "aucun allié sauf l'Allemagne". (4)⇓
Faute de mieux, nous avons toujours considéré, jusqu'ici,
qu'il s'agissait du moins mauvais des legs reçus de la période gaullienne
(1958-1969). La Cinquième république ne faisait, en cela, que continuer la
fameuse déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950. Et rappelons que
celle-ci trouvait elle-même son inspiration dans le discours de Winston
Churchill à Zürich du 19 septembre 1946.
Je souhaite me tromper, quant aux conséquences, mais il me
semble que nous sommes entrés, sous la présidence de "Monsieur
Normal", dans une autre époque.
Il faut, pour le moment, se rendre à l'évidence : entre
Madame Merkel et le président parisien, la coordination est tombée au-dessous
de sa ligne de flottaison minimale. On peut certes souhaiter que les choses
évoluent. Après tout, en 2007, les premiers rendez-vous entre Nicolas Sarkozy
et la chancelière semblaient beaucoup mois chaleureux qu'en 2011.
À l'inverse, si la situation persiste, tous les peuples
européens devront en tirer les conséquences, et ceux qui n'en tiendront pas
compte le payeront cruellement.
M'adressant à des lecteurs francophones, je me vois obligé de
souligner malheureusement ce que les gros journaux de référence, en France
certes, mais aussi La Libre Belgique ou bien le Temps de Genève, n'ont présenté
que de manière fort édulcorée. M. Frédéric Lemaître, correspondant du
Monde à Berlin, titre ainsi : "Hollande ne veut pas se laisser
marginaliser par Merkel". (5)⇓
Voilà qui semble bien modéré au regard de l'atmosphère
exécrable dans laquelle, manifestement, se sont déroulés les entretiens du
23 août. Ils devaient durer de 19 à 21 heures, ils se sont prolongés
jusqu'aux alentours de 22 heures. Les visages tendus pour ne pas dire
hostiles, l'absence d'un communiqué commun, et les courtes déclarations des
deux côtés confirment un grave désaccord.
"La route vers une solution est longue et difficile"
soulignait ce soir-là évoquant la préparation, au niveau intergouvernemental
(entre Paris et Berlin), de l'agenda de décisions à prendre formellement dans
le cadre des institutions communautaires.
 Or, le lendemain 24 août, elle recevait le Premier
ministre grec Antonis Samaras, avec lequel les choses semblent s'être beaucoup
mieux passées (6)⇓ qu'avec le président français. Quelle que soit la sympathie
franco hellénique… dont je me félicite évidemment… et que Pierre Moscovici est
encore allé manifester à Athènes le 13 septembre… (7)⇓ et qui se sentait lorsque
l'on entendit Antonis Samaras s'exprimer le 25 août sur le perron de
l'Élysée dans un français parfait, le chef du gouvernement grec ne peut pas
ignorer qui décide actuellement au sein du concert européen : ce n'est pas
le compagnon de Mme Trierweiler.
Or, le lendemain 24 août, elle recevait le Premier
ministre grec Antonis Samaras, avec lequel les choses semblent s'être beaucoup
mieux passées (6)⇓ qu'avec le président français. Quelle que soit la sympathie
franco hellénique… dont je me félicite évidemment… et que Pierre Moscovici est
encore allé manifester à Athènes le 13 septembre… (7)⇓ et qui se sentait lorsque
l'on entendit Antonis Samaras s'exprimer le 25 août sur le perron de
l'Élysée dans un français parfait, le chef du gouvernement grec ne peut pas
ignorer qui décide actuellement au sein du concert européen : ce n'est pas
le compagnon de Mme Trierweiler.
La veille à Berlin, en même temps qu'elle fixait les
conditions et que, manifestement, elle a accepté le principe d'une révision du
calendrier des obligations de la Grèce, la chancelière lançait une campagne sur
le thème "ich will Europa".
C'est à ce mot d'ordre que répondent les déclarations
pro-fédéralistes des principaux responsables des institutions communautaires,
le président de la Commission [Barroso] comme ceux de l'Eurogroupe [Juncker], du Conseil européen
[Van Rompoy] ou de la Banque centrale [Draghi]. Dans son discours du 12 septembre au Parlement
européen, M. Barroso est allé jusqu'à proposer à la fois "une fédération
démocratique d'États nations" en même temps que "l'union monétaire au
sein de la zone euro".
François Hollande se propose de ratifier à la sauvette
le traité négocié par Nicolas Sarkozy. Contre quoi les communistes et leurs
satellites en appellent de plus en plus fort à une procédure référendaire. En
choisissant la voie subreptice, il montre sa faiblesse. Qu'en sera-t-il dès
lors de sa participation à l'étape suivante, c'est-à-dire au deuxième traité, en cours
d'élaboration ?
JG Malliarakis

Apostilles
- cf. Reuters le 14 septembre. ⇑
- Précisons ici notre pensée, au gré d'un détail typographique : on ne doit pas plus mettre de guillemets à ce projet, – louable et nécessaire dans son principe, – qu'il ne convient d'en apposer au mot France, fût-elle affligée de ce régime destructeur qui se dit "république".⇑
- cf. la courbe actuelle du différentiel vue par Bloomberg et le Temps de Genève
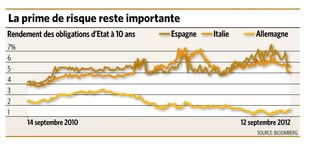 ⇑
⇑
- cf. Son livre "La Politique extérieure de la Cinquième république" 190 pages, Seuil, 1965. ⇑
- cf. cf. Le Monde en ligne le 24 août à 11 h 42. ⇑
- cf. "Merkel donne un peu d'espoir aux Grecs" Der Spiegel en ligne le 25.08.2012 : "Samaras-Besuch in Berlin Merkel macht Griechen ein bisschen Hoffnung".⇑
- cf. son entretien sur Mega TV le 13 septembre : on voit aussi combien "notre" ministre raisonne faux et s'exprime maladroitement, alors qu'il est venu pour manifester le soutien de la France. ⇑
Si vous appréciez le travail de L'Insolent
soutenez-nous en souscrivant un abonnement.
Pour recevoir régulièrement des nouvelles de L'Insolent
inscrivez-vous gratuitement à notre messagerie.

Les commentaires récents